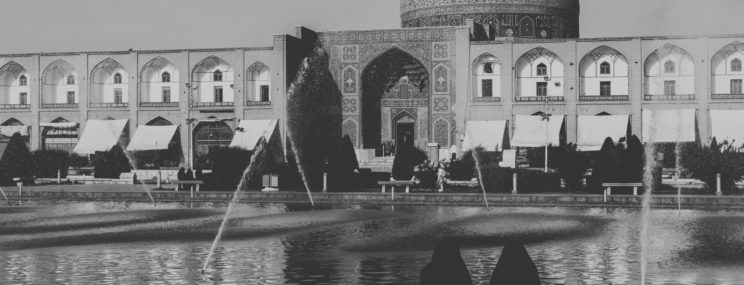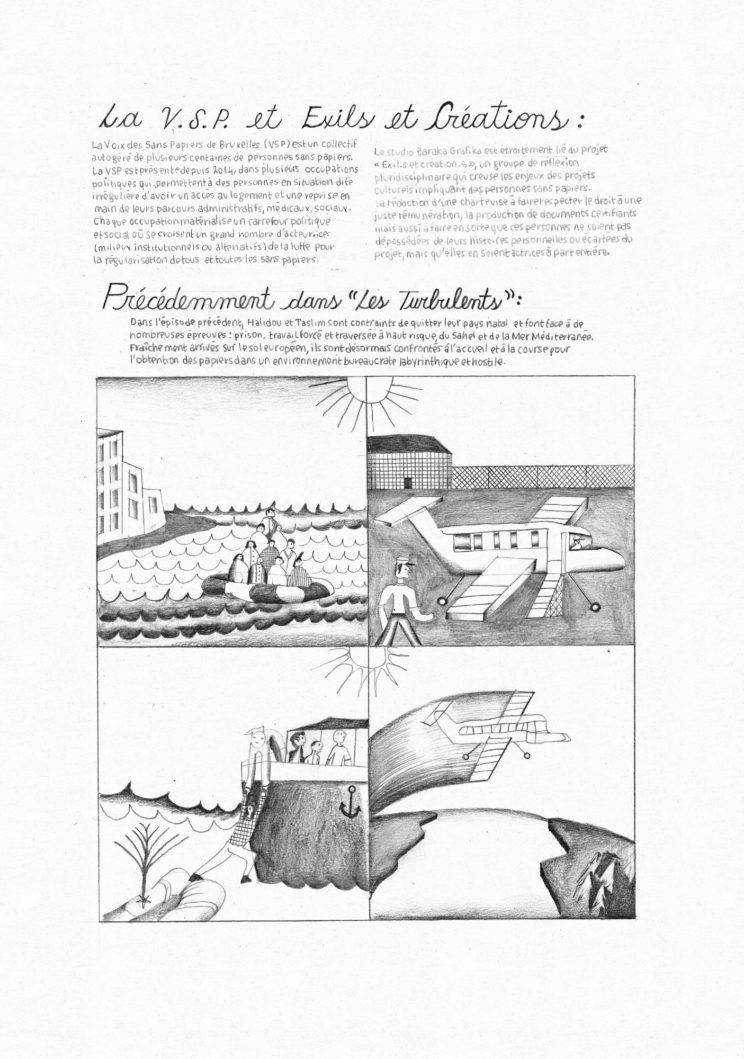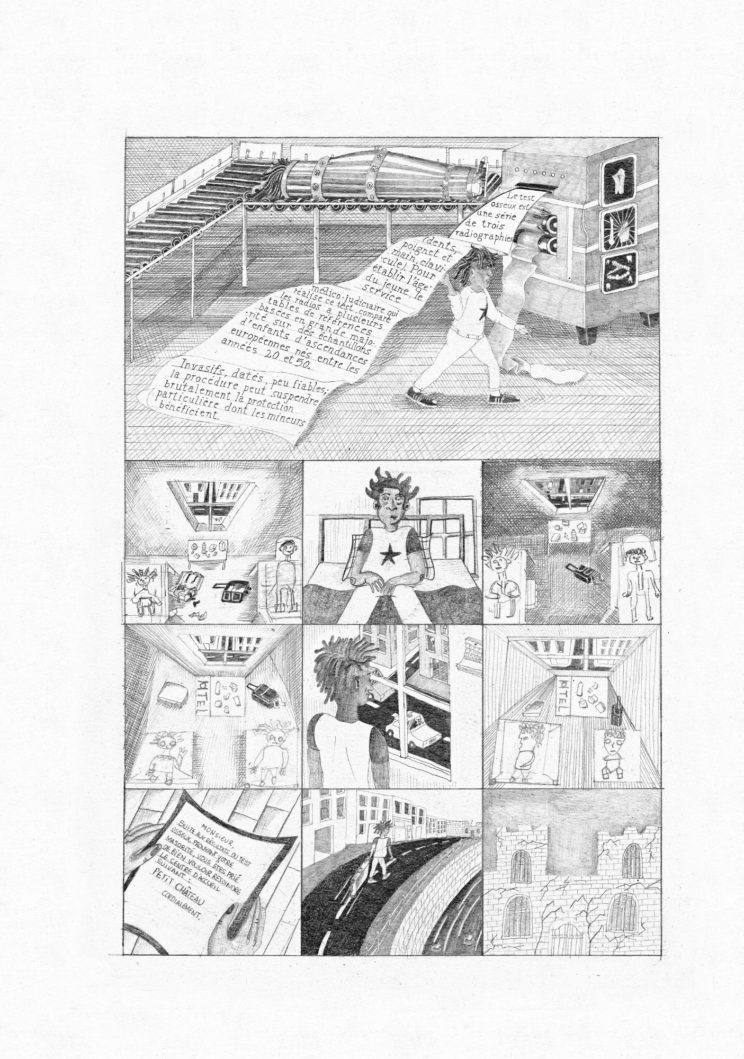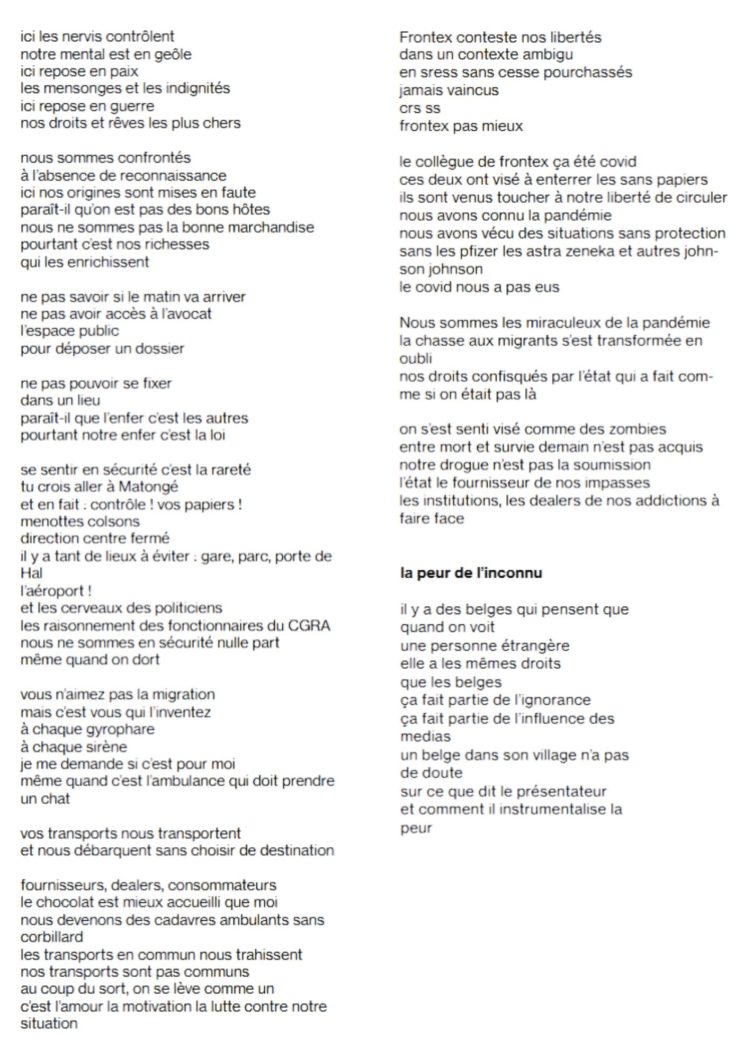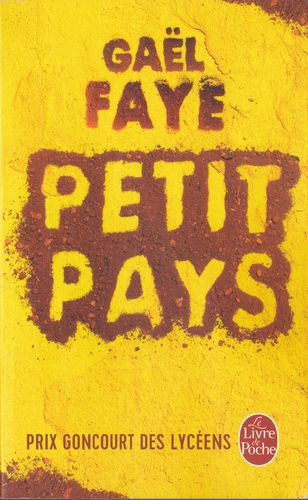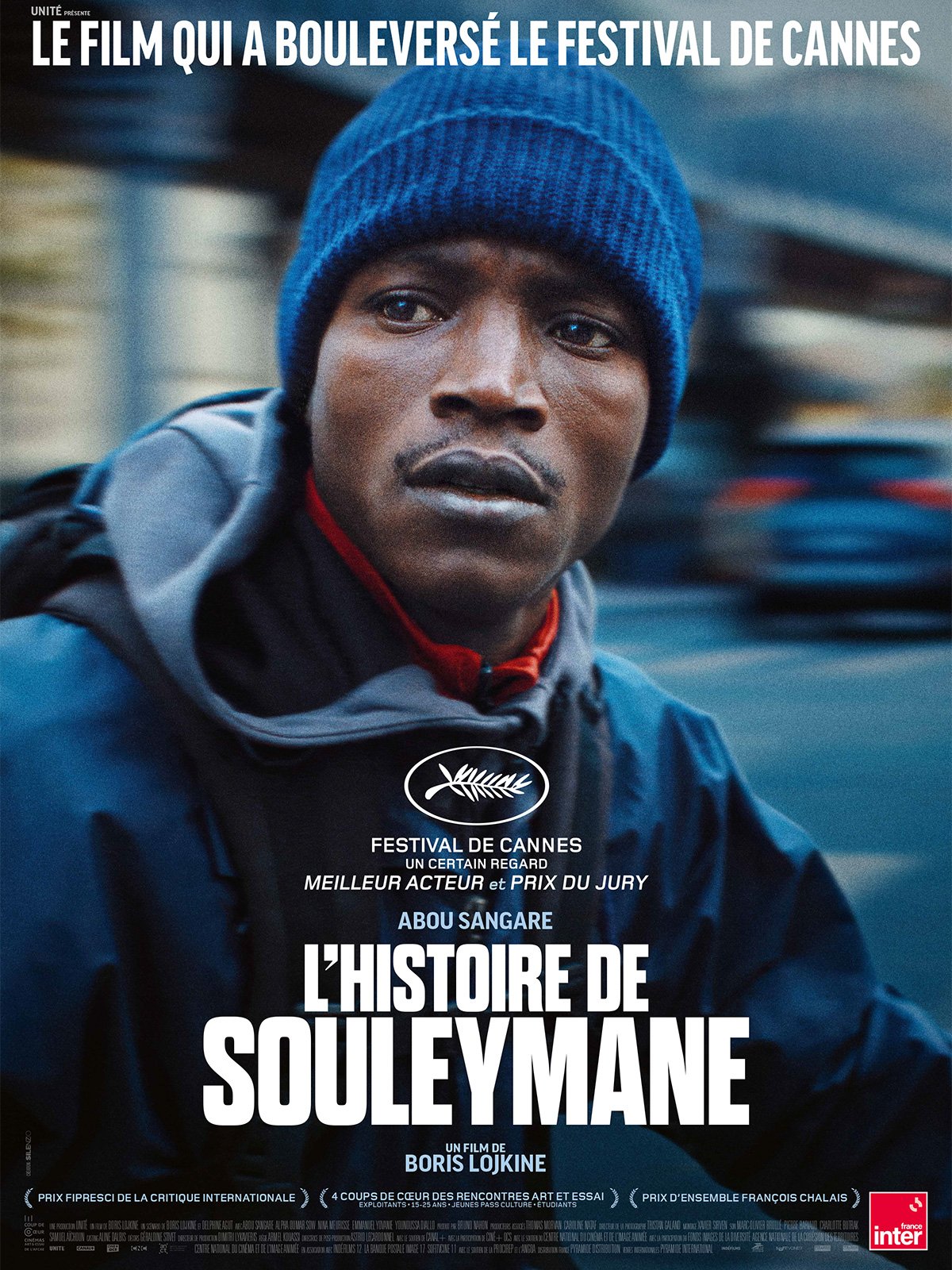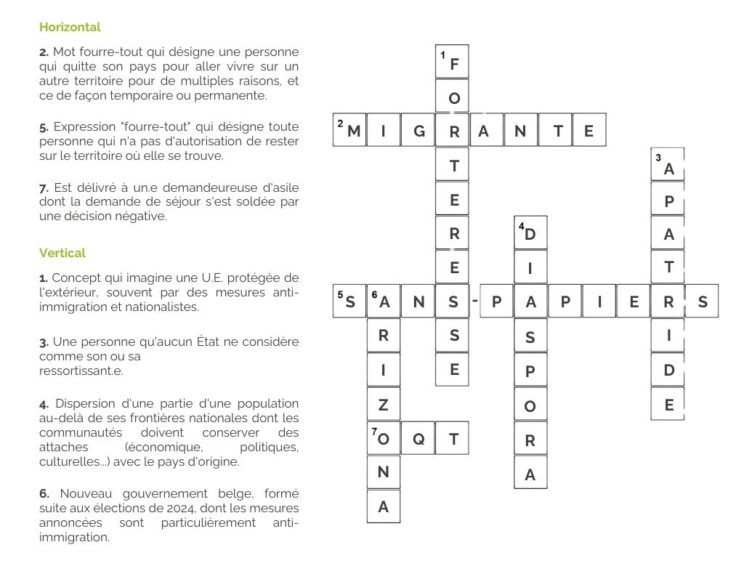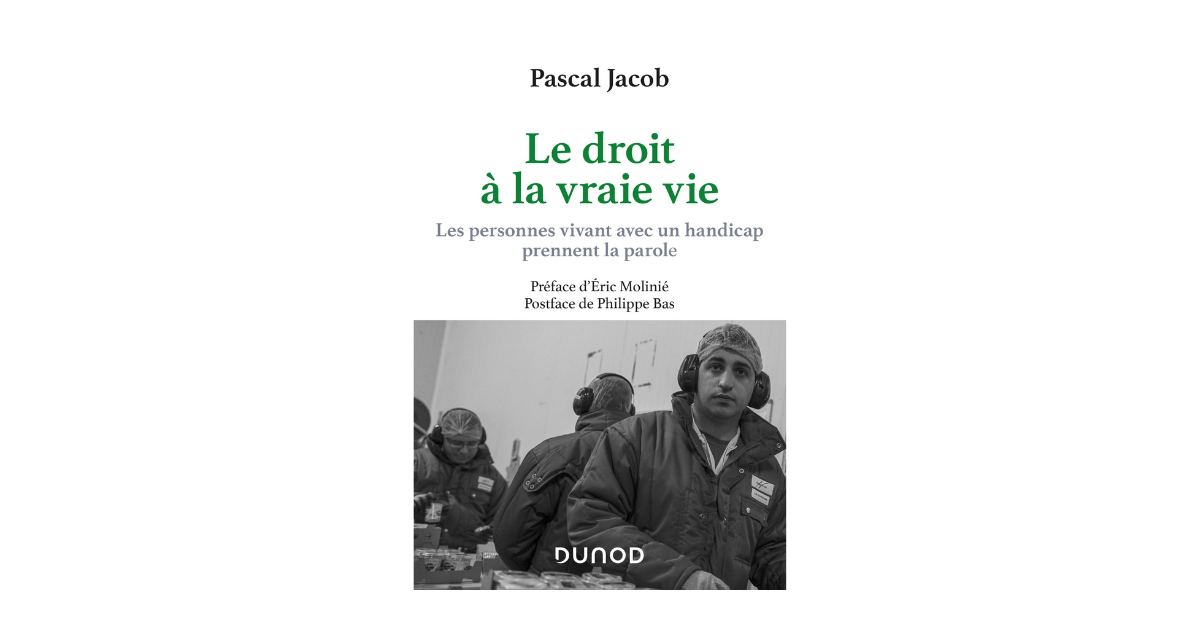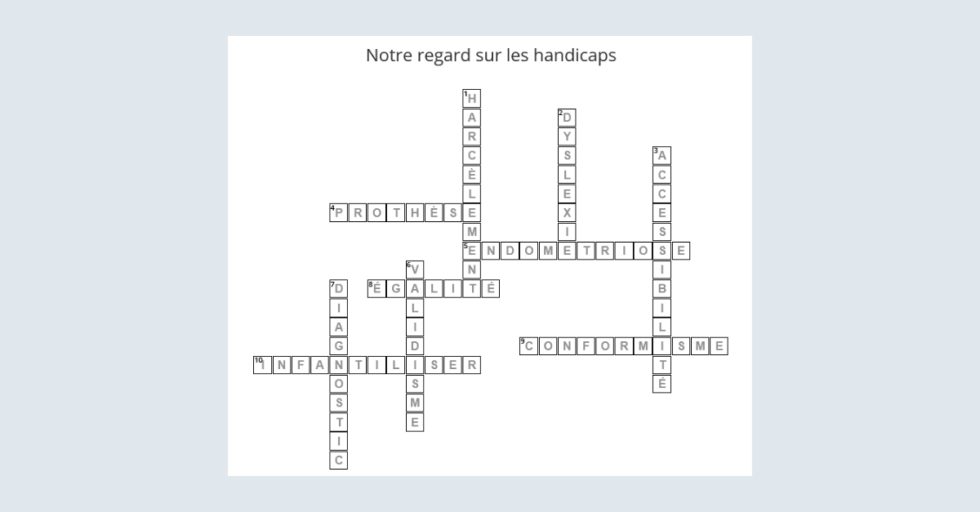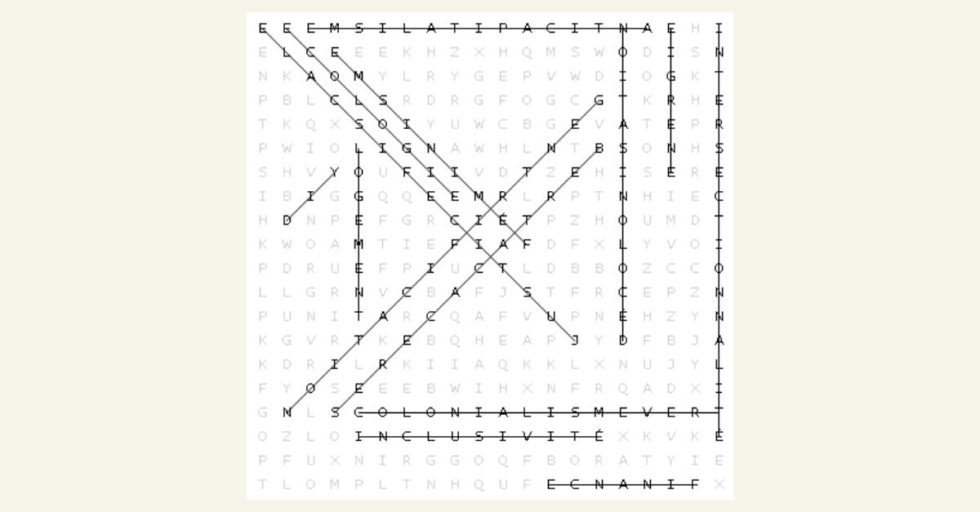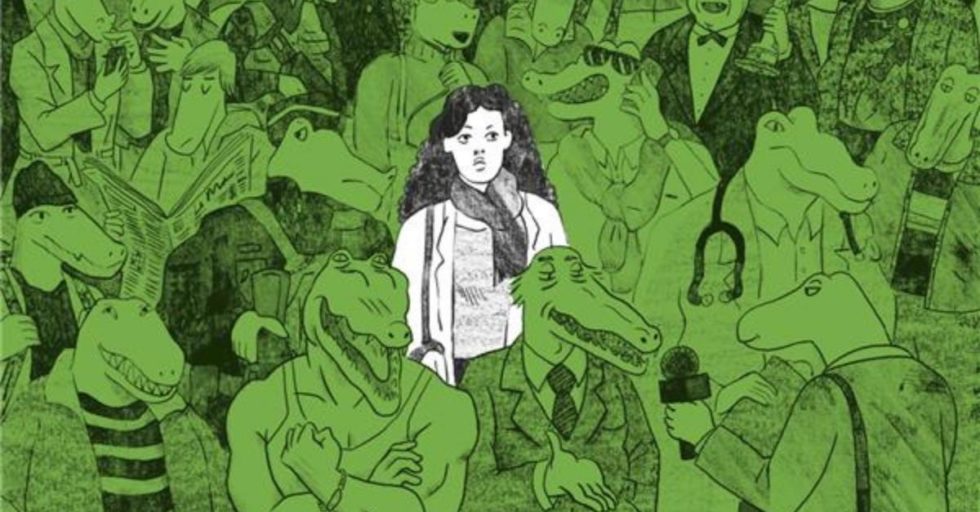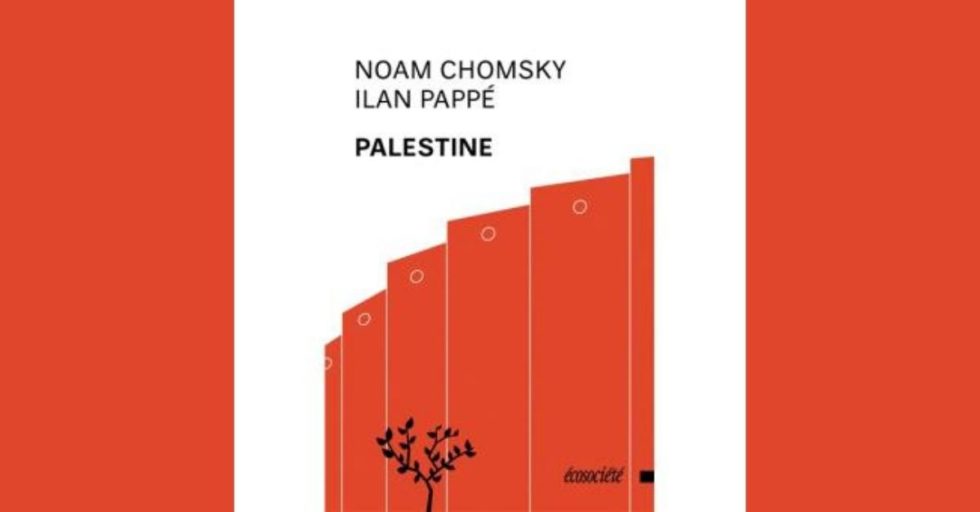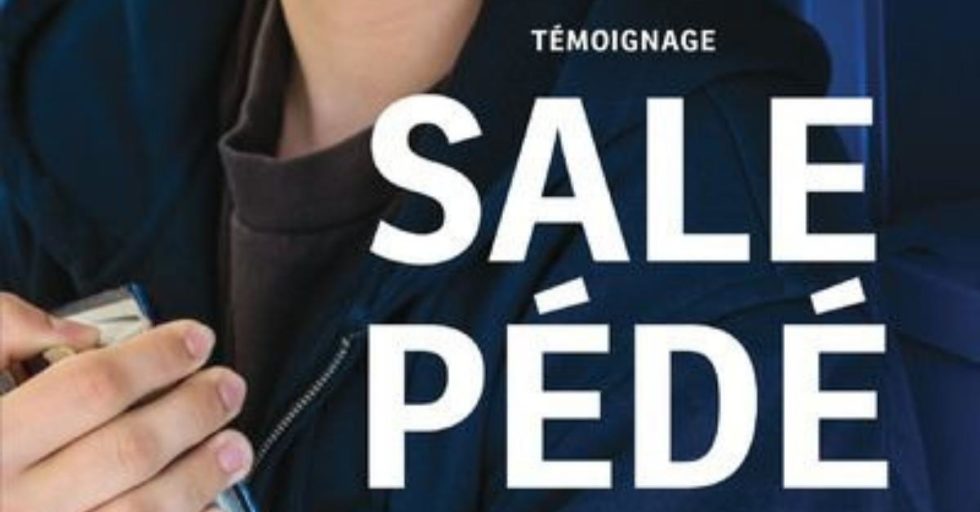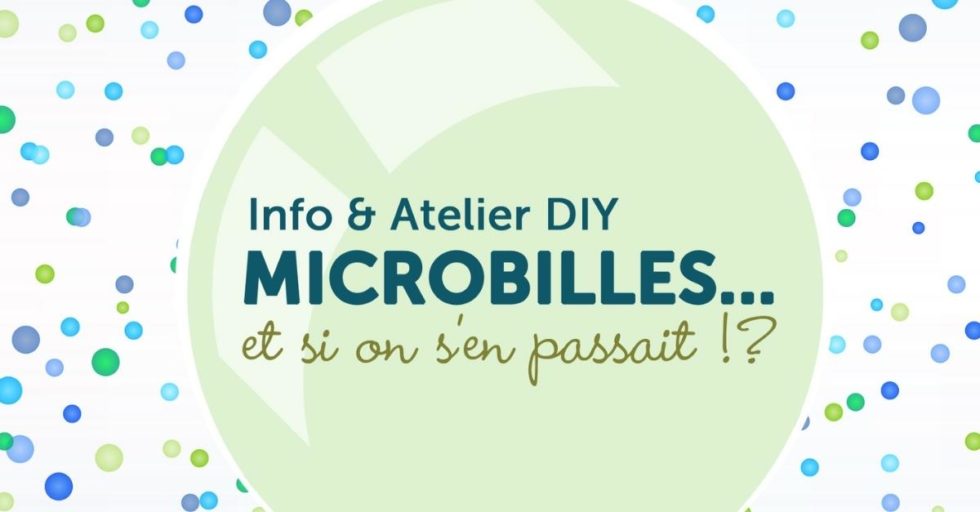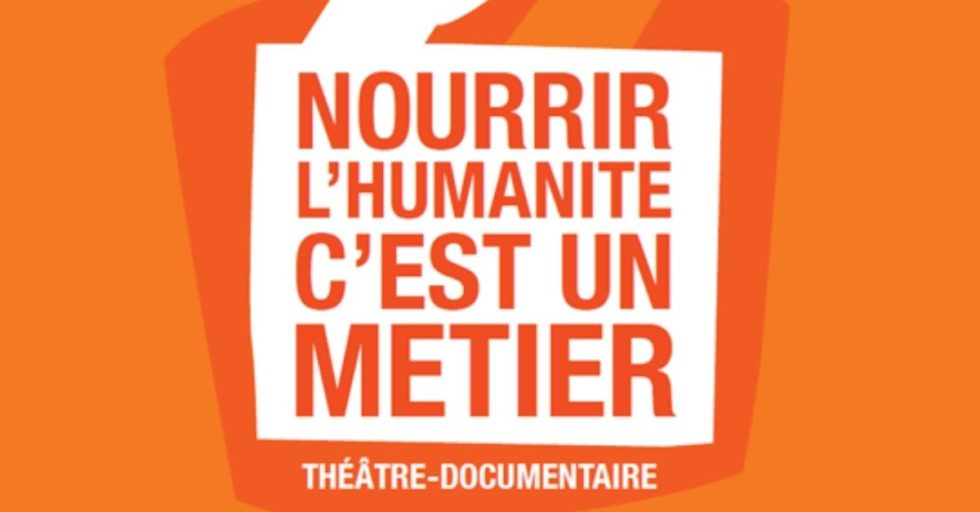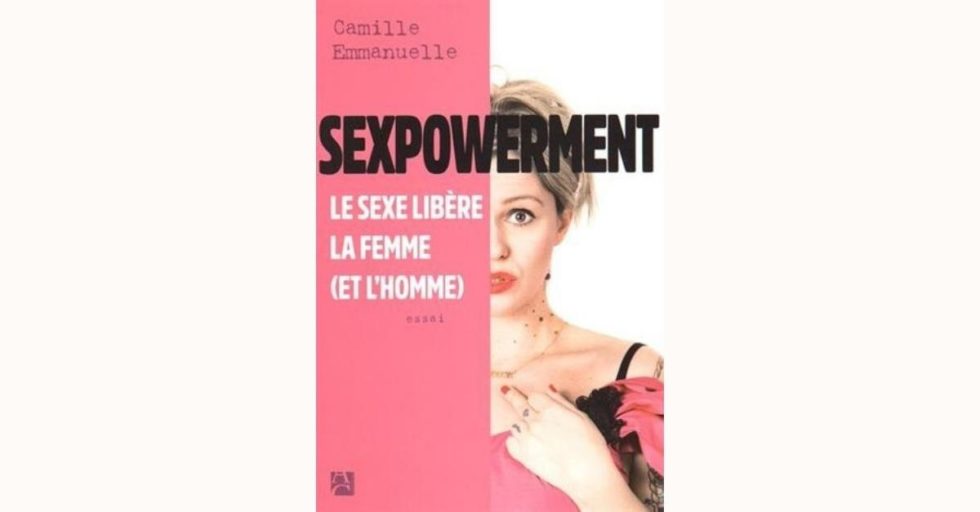Entretien avec Pharell Tachago, porte parole de la Plateforme de Lutte pour l’Amelioration des Droits des Étudiant·es Étranger·ères (PLADE), mars 2025.
1) Peux-tu nous expliquer ce que c’est la PLADE ? Quels sont vos combats ?
La Plateforme de Lutte pour l’Amelioration des Droits des Étudiant·es Étranger·ères a été créée en 2022 lorsqu’un grand nombre d’Ordres de Quitter le Territoire (OQT) ont été délivrés à des étudiant·es étranger·ères pour des raisons jugées illégitimes par les membres de la plateforme (vices de procédures).
En conséquence, nombreux·ses étudiant·es étranger·ères ont manifesté leur ras-le-bol et ont créé cette plateforme. Nous avons mené plusieurs actions parmi lesquelles :
En 2023, nous avons organisé avec la FEF deux grandes manifestations fédérales à Bruxelles, au niveau de l’office des étrangers et du cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur.
Un niveau plus local, nous militons auprès des conseils des étudiant·es pour pousser les administrations à permettre à des étudiant·es étranger·ères dont les dossiers de résidence sont “en cours” de tout de même continuer leurs études en attente de la réponse définitive des autorités. Nous avons particulièrement agi là dessus à l’UMons.
Nous accompagnons aussi les étudiant·es étranger·ères lors de leur arrivée en Belgique, en particulier pour le côté administratif. Souvent, iels arrivent à 18-19 ans, leurs parents ont fait les la majeure partie de la procédure administrative de voyage) et donc iels ne connaissent pas les procédures administratives. L’objectif est surtout de leur expliquer comment celles-ci fonctionnent, des règles à respecter, qu’est-ce qu’un·e garant·e… faciliter leur insertion.
2) Quelles sont les difficultés rencontrées par les étudiant·es étranger·ères qui étudient en Belgique.
Les démarches administratives de renouvellement de titre de séjour, en plus d’êtres nombreuses et chronophages, ne s’accordent pas à la temporalité des étudiant·es. En effet les titres des séjour ne sont valables qu’un an et périment chaque année le 31 octobre alors que la procédure de renouvellement prend parfois plus de 5 mois, des étudiant·es ne reçoivent leur renouvellement qu’en avril ou mai de l’année suivante. Cela signifie deux choses : iels se retrouvent sans titre de séjour (hormis un document provisoire qui atteste qu’iels ont entamé la procédure) pendant 5 mois et une fois le titre de séjour reçu, il n’est réellement valable que 6 mois avant de périmer de nouveau fin octobre.
Pendant les 5 mois d’attente, les étudiant·es étranger·ères ne peuvent pas quitter le territoire belge et peinent à trouver ou conserver leurs jobs étudiants sans pouvoir montrer leurs papiers en règle. L’incapacité de se mouvoir, pour des personnes dont la famille ne vit souvent pas en Belgique, les empêche de voir leurs familles, de voyager.
Ensuite, à la PLADE nous avons remarqué que, lors du traitement des dossiers par le service des étrangers, à dossiers équivalents (même profil, garant·es, crédits,…), certains dossiers sont traités par la commune et d’autres par l’office des étrangers. Rien n’explique cette différence mais l’un des deux prend deux fois plus de temps et garde les étudiant·es étranger·ères dans l’incertitude.
Enfin, pour obtenir un titre de séjour étudiant, les jeunes doivent prouver la “solvabilité moyenne de subsistance” de leurs garant·es. Quand je suis arrivé en Belgique en 2020, mes garant·es devaient prouver avoir un revenu net mensuel d’un peu plus de 1900 euros, aujourd’hui c’est environ 2700 euros. Ces sommes sont énormes et leur augmentation met à mal les jeunes qui souhaitent étudier en Belgique mais aussi celleux déjà en plein cycle d’études. En effet, ce seuil augmente même pour les étudiant·es déjà inscrit·es. C’était mon cas, et c’est le cas de centaines d’étudiant·es étranger·ères en Belgique. Dans l’incapacité de prouver une solvabilité soudainement 45% plus élevée que prévue lorsqu’on a commencé nos études en Belgique, on se retrouve à recevoir un OQT et devoir mettre fin à nos études.
Lorsqu’on prévoit de venir étudier en Belgique, on fait un plan financier de combien ça va nous coûter. Pour vivre, un·e étudiant·e en Belgique dépense environ 10 000 euros par an (loyer, nourriture, matériel scolaire…). Un·e jeune étranger·ère qui étudie l’ingénierie depuis 3 ans et qui a donc déboursé 30 000 euros, se retrouve du jour au lendemain sans diplôme d’ingénieur, sans travail, 3 années de vie et 30 000 euros perdus, et avec un OQT. C’est une perte d’argent et de temps considérable !
3) Quelles solutions pragmatiques pour l’amélioration des droits des étudiant·es étranger·ères ?
Une première revendication de la PLADE a été la possibilité d’avoir une caisse de dépôt sur laquelle les étudiant·es étranger·ères peuvent déposer petit à petit la caution : une sorte de cotisation pour les années qui arrivent. Aujourd’hui, ce sont des entreprises privées qui nous donnent cette possibilité, c’est donc un bon début. Aujourd’hui, nous nous focalisons sur les revendication suivantes :
-
Allongement de la durée de validité des titres des séjour étudiants à 2 ans minimum : Même si les démarches administratives sont trop longues et durent 6 mois, les étudiant·es auraient encore 1 an et 6 mois de validité (au lieu de 6 mois à peine) pour travailler, voyager pour voir leurs familles, étudier…
-
Décentralisation effective du système d’octroi des titres de séjour : Donner plus de pouvoir aux communes, leur octroyer la compétence de traiter les dossiers et obtenir un processus plus clair et qui justifie systématiquement le transfert éventuel d’un dossier vers l’office des étrangers ou ailleurs afin d’alléger la charge administrative de l’office des étrangers et faire preuve de plus de transparence.
-
Retirer le facteur de lien de parenté des conditions pour devenir garant·e : Actuellement, si le·a garant·e est de nationalité hors Union européenne, iel doit obligatoirement prouver un lien de parenté au 3e degré avec l’étudiant·e en demande de titre de séjour. Ainsi, si un·e ami·e de la famille veut aider, iel ne le peut pas, tout comme si on n’a pas de famille proche, ou qu’on devient orphelin. Cela limite trop les possibilités.
-
Retirer la rétroactivité des lois concernant les conditions d’accès à un titre de séjour étudiant : Si l’étudiant·e arrive en Belgique avec un·e garant·e solvable mais que le seuil de solvabilité augmente 1 an plus tard, soudainement lae garant·e n’est plus solvable. Il faut empêcher ce changement en plein parcours : si quand j’arrive, je dois avoir un·e garante qui prouve avoir 2000 euros de salaire net, et que j’ai organisé tout le financement de mes études basé là dessus, augmenter ce seuil me met à risque de ne plus pouvoir continuer mes études et de recevoir une OQT ! Cela vaut pour tous les changements qui affecteraient notre accès ou non à un titre de séjour étudiant : les conditions ne doivent pas évoluer en plein milieu de nos études.
– Pharell Tachago, porte parole de la PLADE.